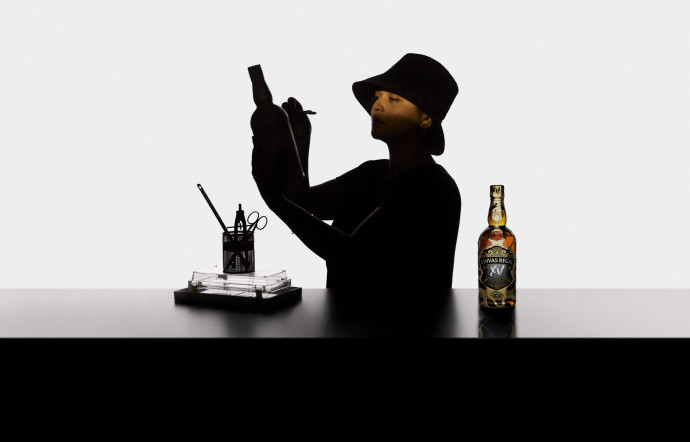- Non classé>
Sécuriser l’un des plus grands domaines du monde représente une sacrée responsabilité. Nous étions dès les premiers jours d’ouverture de la saison à Tignes pour mieux en comprendre les enjeux. Notre guide : le directeur de la régie des pistes, Frédéric Bonnevie : un nom prédestiné !

En piste avec les super-pros de la sécurité en montagne
Nous sommes tout début décembre, la neige est là, pas en grande quantité mais de manière suffisante. Il fait froid, sec et grand beau sur le glacier de Tignes, l’un des points culminants des Alpes avec ses 3 450 m d’altitude, prêt à recevoir ses premier skieurs de la saison. Nous prenons la toute première cabine, les yeux pleins de blanc et de bleu, avec une vue imprenable sur le Mont Blanc qui semble tout proche – magie des perspectives de massifs.

Une toute première descente permise grâce au travail de super-pros de la montagne : 60 pisteurs secouristes de la station, dont un quart de femmes, reconnaissables à leur tenue noire et jaune siglée Ski Patrol/Sécurité des Pistes et signée Helly Hansen, le leader de l’équipement des stations avec 55 000 professionnels dans le monde. On compte aussi 28 dameurs, 4 mécaniciens et 3 nivoculteurs (ou snow makers).
Directeur des pistes, un métier de terrain
À la tête de ces équipes, Frédéric Bonnevie, 46 ans. Dès ses 18 ans, il obtient ses diplômes de pisteur secouriste et moniteur de ski, puis passe rapidement adjoint de secteur. Depuis ses 20 ans, il occupe des postes à responsabilité, notamment dans son village de Val D’Isère, de l’autre côté de la montagne. Après 23 ans de travail sur ce domaine skiable, il devient directeur des pistes de la station de Val Thorens, avant de reprendre le même poste à Tignes en 2020.

“Les prises de décisions sont faites selon la réalité du terrain et pas dans un bureau. Même avec un risque d’avalanche de niveau 5, une partie du domaine skiable peut tourner.” – Frédéric Bonnevie

Un pur métier passion : “La gestion du risque demande une attention de tous les instants. Je suis garant de la sécurité du domaine skiable, mais aussi de la route,” explique-t-il. La coordination de la mise en œuvre des moyens concerne autant la prévention, les secours, le damage ou encore la production de neige… Éclectique et complet, donc. “Les prises de décisions sont faites selon la réalité du terrain et pas dans un bureau. Même avec un risque d’avalanche de niveau 5, une partie du domaine skiable peut tourner.” La communication est partie intégrante du job : en 45 minutes d’interview, toujours en veille, Frédéric recevra une quinzaine de coups de fil, jusqu’à 200 par jour nous avoue-t-il, sans compter les contacts radio permanents. Sa journée commence tôt : à 5h30, il fait un point avec les dameurs, puis part lui-même sur le terrain en ski de randonnée ou motoneige pour constater les conditions. “Nous sommes de vrais privilégiés. Les métiers du secours forgent le caractère et apprennent à vivre”.
Bien s’équiper pour se sécuriser en freeride
Sortir des sentiers battus des pistes damées demande de l’expérience et un équipement adéquat. Tout d’abord, il est toujours utile de se faire accompagner de guides locaux qui sauront à la fois évaluer les dangers et faire découvrir les meilleurs spots du jour, selon les conditions. Quant à l’équipement, il se compose d’abord d’un trio à toujours emmener dans son sac à dos (idéalement un sac airbag pour flotter à la surface de la neige en cas d’avalanche) : sonde, pelle et DVA (détecteur de victimes d’avalanches). Ils permettent de retrouver au plus vite un compagnon de freeride ou de randonnée pris sous la neige, puis de le dégager avant 15 minutes, limite souvent fatidique. Pour apprendre à utiliser ce matos, la marque spécialisée Ortovox propose des stages ouverts à tous avec sa Safety Academy.
En complément, le système de communication par satellite Garmin InReach permet d’alerter les secours même dans des zones blanches, tandis que l’appli Echo Locator peut indiquer facilement la localisation. Les réflecteurs Recco intégrés dans les équipements d’habillement aident aussi les secours pour un repérage rapide. Des vêtements qui doivent être adaptés aux conditions, selon le principe des 3 couches : un sous-vêtement technique évacuant la transpiration, une couche intermédiaire chaude et une veste imperméable et respirante. Ajoutez un bon casque, un masque optique à l’indice UV élevé et des gants chauds, et vous voici équipé pour partir à la découverte de la face cachée de la montagne.

Les nouvelles technologies, cauchemar de la sécurité sur les pistes ?
Mais il s’agit aussi d’un métier qui évolue avec l’augmentation des comportements à risque liés à l’usage de nouvelles technologies qui poussent skieurs et snowboarders à plus de performances. Ils suivent leurs traces dans des applis spécialisées, se filment avec leurs GoPros et l’évolution du matériel leur permet des vitesses toujours plus élevées, surtout sur des pistes boulevards ultra damées.

On relève également de plus en plus de problèmes de drogues et d’alcool, parfois même dès le matin… Mais le travail des pisteurs n’a pas de caractère répressif. Patrouillant dans les 4 secteurs la stations, entre 1 500 et 3 500 m d’altitude, ils veillent et restent pédagogues. Sur 150 jours de saison, environ 1 500 secours sont effectués, même si tout est fait pour limiter l’accidentologie : un damage soigné, l’implantation de chicanes dans les endroits délicats et un dessin des pistes pensé pour un risque moindre. Un travail sans fin au service du pur plaisir des sports d’hiver, qui prend toute sa valeur dans une station de haute montagne à la réputation mondiale comme Tignes.
N.V
Lire aussi
The Good Mountain : Zoom sur le marché du ski argentin
Canada : 11 bonnes adresses dans la station de ski de Whistler
The Good Spots : 25 hôtels à la montagne dans le monde