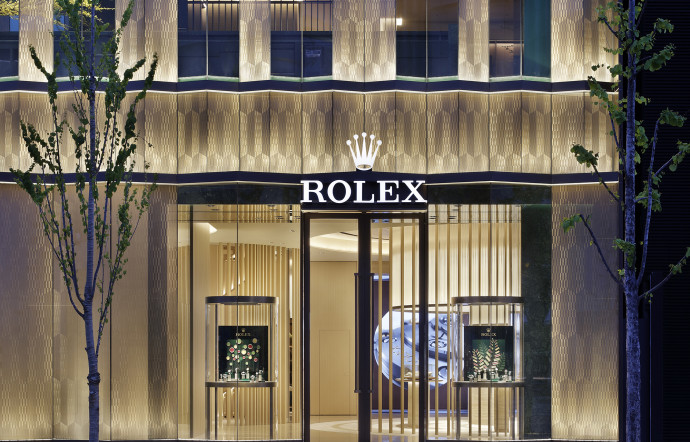- Architecture>
Emblématique de l’architecture moderniste d’après-guerre, ce chef-d’œuvre de béton armé situé dans le 7e arrondissement de Paris fait face à l’épreuve du temps. Rongée par la carbonatation, maladie connue de ce type de structure, l’institution peine à masquer la corrosion qu’elle subit.
Faire accepter la Maison de l’UNESCO aux Parisiens n’était pas chose acquise. L’édification de ce bâtiment moderniste en béton dans le très chic 7e arrondissement de la capitale, quartier hautement conservateur sur les questions de patrimoine, relevait de l’anomalie, voire de la provocation.
Lire aussi : Le Havre : de la cendre à l’UNESCO, récit d’une cité sacrifiée

Peut-on dire que l’UNESCO jure pour autant ? Certainement pas. L’immeuble jouit d’une immunité, comme une aura qui le protégerait des accusations de lourdeur et de mauvais goût. Après tout, l’excellence n’est-elle pas le plus efficace des laisser-passer ? Il faut aussi relever que ce paquebot bénéficie d’un régime d’extraterritorialité, c’est-à-dire qu’il est administré indépendamment des lois françaises.
Mille personnes de toutes nationalités travaillent dans cette enclave finalement assez discrète et méconnue, petite tour de Babel au service de la culture et de la paix. L’UNESCO est de ces quelques institutions qui confèrent à Paris son statut de ville-monde, faisant de la capitale un centre culturel au rayonnement sans égal, ou presque. La Ville Lumière retrouve ainsi en cette seconde moitié du XXe siècle le rang – l’honneur – qu’elle semblait avoir perdu.
Une œuvre emblématique du modernisme d’après-guerre
Le siège est inauguré par le président René Coty le 3 novembre 1958. Il aura fallu trois années pour ériger un bâtiment qui soit à la hauteur de cette mission d’importance. Le Palais a été conçu par trois architectes de renommée mondiale : l’Italien Pier Luigi Nervi, le Français Bernard Zehrfuss et l’Américain d’origine hongroise Marcel Breuer, ancien enseignant à l’école du Bauhaus.

C’est un style résolument en rupture qui défraye alors la chronique. La ville d’Haussmann était jusque-là épargnée par cette tendance moderniste internationale. Mais en cette période d’après-guerre, un élan de progrès s’empare des courants intellectuels, artistiques et politiques, et l’on porte un regard nouveau, résolument optimiste, sur l’avenir.
L’incroyable liberté du béton
La singularité de l’immeuble tient dans sa configuration, décrite comme un Y ou bien une étoile à trois branches recourbées, forme qui se rapproche de l’idéogramme chinois signifiant « humanité ». Ce tracé est une ode à la circulation : rien ne doit rester statique, car les rencontres humaines donnent lieu à l’échange des savoirs. Breuer était un disciple de la formule « la forme suit la fonction » : cette hélice est une formidable machine à rencontres, où l’on ne fait que croiser des personnes de langues et de cultures différentes.
Cette forme atypique donne aussi lieu à de longs couloirs à la profondeur visuelle graphique marquée. Rien n’est laissé au hasard dans l’esthétique du site : le bâtiment dégage une impression de grandeur, de modernité intemporelle, inaltérable. La structure qui régit cet ensemble monumental est totalement novatrice : la souplesse du béton armé permet une liberté immense dans la création.

L’unicité de cette architecture hors normes se révèle dans la diversité des formes et l’absence d’ornements superflus, qui n’empêchent pas une certaine poésie d’entrer comme par effraction. Un langage géométrique simple mais infiniment subtil. Les sept étages de l’immeuble reposent ainsi sur soixante-douze pilotis qui donnent au hall d’accueil l’allure d’un squelette d’animal marin.
Les piliers en tripode se terminent en cylindres ou, au contraire, les formes rondes s’évasent pour se transformer en carrés. Les concaves deviennent convexes, le béton mute selon les angles, joue du décalage permanent entre opaque et transparent, lumineux ou bien obscur.
L’UNESCO : dialogue avec l’art contemporain
Cette esthétique d’avant-garde est dès l’origine vouée à dialoguer avec des œuvres d’art du monde entier. Onze ont été commandées à de grands artistes de la scène contemporaine lors de la conception du site, parmi lesquelles Le Mur de la Lune et Le Mur du Soleil de Joan Miró et José Llorens Artigas, Le Mobile à côté du Grand Immobile d’Alexander Calder ou encore la massive Silhouette au Repos du sculpteur britannique Henry Moore. L’UNESCO détient une collection universelle de plus de 2 000 pièces, la plus grande du système des Nations Unies.
Simplement, même le plus sacré des bâtiments en béton ne peut résister à l’épreuve du temps. Soixante-dix ans après les premiers coups de pioche, la Maison de l’UNESCO se détériore aujourd’hui, elle s’effrite çà et là. Il suffit d’une simple visite pour comprendre que le palais souffre d’une corrosion avancée, maladie bien connue du béton armé nommée carbonatation. L’institution peine à cacher les quelques crevasses qui la rongent.

Architecte spécialiste de la rénovation de ce type de monuments en béton, François Chatillon nous éclaire sur le procédé qui mène au délitement de ces bâtiments d’après-guerre. « Le béton armé est un matériau qui vieillit assez mal du fait de son hétérogénéité. Le béton lui-même ne vieillit pas, le problème vient des aciers à l’intérieur », nous explique-t-il ainsi.
Avec le temps, les échanges avec l’atmosphère et l’eau mènent à une oxydation de ces aciers qui gonflent alors, créant des pressions, jusqu’à ce que le béton cède. « C’est un problème mondial, reprend le spécialiste. Or, plus on attend pour intervenir, plus le bâtiment se détériore rapidement. Ça met cinquante ans à se détériorer, et après dix ans à s’effondrer », prévient-il.

On n’en est certes pas là, mais il faut agir. Si des méthodes de restauration par électrolyse existent, elles restent extrêmement coûteuses. Peu prolixe sur la question, la direction de l’UNESCO nous a fait savoir qu’une équipe est en cours de recrutement pour pallier ce problème, se refusant à donner davantage de détails. C’est une réputation qui est en jeu.
Lire aussi : Bauhaus : l’utopie artistique qui a transformé Weimar (et le monde)