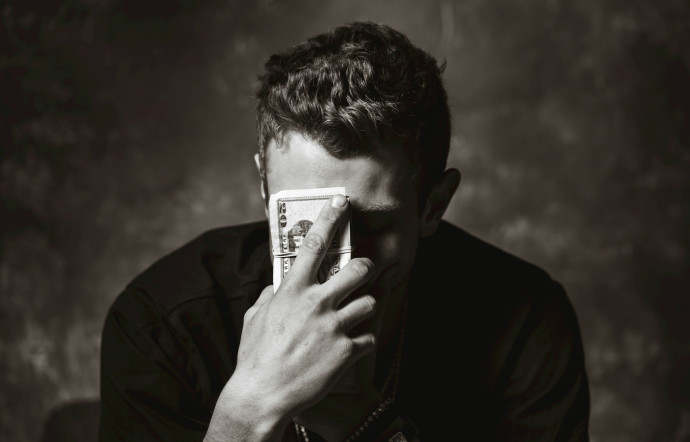The Good Business
C’est « le » journal phare de la capitale du pays le plus influent du monde. C’est avec le scoop historique du Watergate dans les colonnes du « Post », comme on l’appelle aux États‑Unis, que s’est popularisée l’expression « quatrième pouvoir » pour désigner celui de la presse. Non content d’avoir ainsi contraint un président des États‑Unis à démissionner ou de collectionner, année après année, les prix Pulitzer grâce à ses scoops, le Post s’offre le luxe, au bout de près d’un siècle et demi d’existence, de réussir avec brio sa mutation numérique.
En chiffres
- Quotidien généraliste fondé en 1877 par Stilson Hutchins.
- Racheté en 1933 par le banquier Eugene Meyer.
- Katharine Meyer Graham devient propriétaire du journal en 1948.
- 1970 : nomination d’un médiateur pour veiller sur l’indépendance du journal.
- 1973 : le Washington Post reçoit le prix Pulitzer pour la révélation des écoutes du Watergate, scandale qui oblige le président Richard Nixon à démissionner.
- Propriétaire actuel depuis 2013 : Jeff Bezos (100 %).
- Directeur de la rédaction : Marty Baron.
- Effectifs de la rédaction : 700.
- Audience édition papier : 1 090 000 lecteurs en semaine et 1 516 000 le dimanche.
- Trafic des éditions numériques : environ 70 M de visiteurs uniques par mois (en hausse de 30 % par rapport à 2015).
- Prix édition papier : 2 $ en semaine, 3,50 $ pour l’édition du dimanche et 10,75 $ l’abonnement hebdomadaire.
- Abonnement premium digital : 149 $.
Quotidien le plus influent des États-Unis, le Washington Post jouit d’une légende que de prestigieuses personnalités, actionnaires ou journalistes, ont contribué à façonner. Le premier nom qui vient à l’esprit est celui d’une femme à la ténacité et au courage exceptionnels. Héritière d’une puissante famille de l’establishment financier de la côte Est, Katharine Meyer, passionnée de journalisme, publie ses premiers papiers à 21 ans, en 1938, dans le Washington Post. Ce n’est alors qu’un petit quotidien déficitaire que son père a acquis cinq ans plus tôt pour 825 000 dollars. Elle épouse bientôt un juriste et sénateur de Floride, brillant mais instable, Phil Graham, qui bâtira un empire de presse en rachetant successivement, dans les années 50 et au début des années 60, le Times Herald, CBS Television, l’Evening Star, Newsweek… Mais Phil, qui est maniaco-dépressif, se suicide d’un coup de revolver en 1963. Katharine, bien qu’elle ait été déshéritée par son mari, parvient à reprendre le contrôle du journal avec la farouche volonté d’en faire un titre indépendant et influent. Conseillée par son nouvel actionnaire, le mirobolant Warren Buffett, elle nomme un directeur de la rédaction d’exception, Ben Bradlee, qui deviendra une légende du journalisme en dirigeant le « Post » vingt-trois ans d’affilée, entre 1968 et 1991 ! En 1972, aux côtés de Ben, Katharine Graham va soutenir bec et ongles ses deux opiniâtres journalistes d’investigation Carl Bernstein et Bob Woodward. Ce sont eux qui ont révélé le scandale des écoutes téléphoniques du Watergate, cet immeuble siège du Parti démocrate, espionné sur ordre du président des États-Unis, le républicain Richard Nixon. Démasqué, le « Tricky Dick » de la Maison Blanche essaie par tous les moyens de couler le Post : pressions financières en tout genre (y compris une tentative d’OPA !), chantage, menaces, même physiques… Mais Katharine Graham, à qui le chef de l’État a prédit « de très gros ennuis », tient bon et est adulée par la rédaction, qui la surnomme « la Grande Katharine ». En 1974, Nixon doit démissionner et la vaillante Katharine sera décorée, en 2002, de la médaille de la Liberté par le président George W. Bush, lui aussi issu du Parti républicain ! Quant à Ben Bradlee, qui comptait John Fitzgerald Kennedy parmi ses amis, il publiera en 1995, à l’âge de 73 ans, ses palpitantes mémoires qui deviendront un best-seller sous le titre de… A Good Life ! Aujourd’hui, au septième étage de l’immeuble de Washington qui abrite, à deux pas de la Maison Blanche, le millier de collaborateurs du Post, les rédacteurs en chef se réunissent chaque jour dans la « Ben Bradlee Conference Room » et ce n’est que justice pour un Executive Editor qui, pendant son règne, a fait bondir la diffusion du quotidien de 400 000 à plus de 800 000 exemplaires !

Un rachat à 250 millions de dollars
L’actuel propriétaire du Post s’inscrit sans aucun doute, comme Katharine Graham, Warren Buffett ou Ben Bradlee, dans cette lignée de personnalités d’exception. Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, classé parmi les vingt premières fortunes du monde et considéré à Wall Street comme le meilleur homme d’affaires des États-Unis, a racheté cash, en octobre 2013, pour 250 millions de dollars, le fameux quotidien de l’establishment américain. C’est lui qui a choisi pour le Post, voilà bientôt un an, ce nouveau et somptueux siège social au hall d’entrée et aux couloirs de marbre blanc, aux immenses newsrooms design (6 000 m2) dont les murs et les parois de verre sont agrémentés de collections de médailles et de listes de lauréats maison du prix Pulitzer ou de titres de une du Post devenus célèbres, tels que « Staline is dead », « Nixon resigns », « Israel and PLO sign peace pact »…

Et là, en évidence, peinte sur fond bleu horizon, dans le couloir central de la newsroom, cette citation signée Jeff Bezos : « What’s dangerous is not to evolve » (« ce qui est dangereux, c’est de ne pas évoluer », NDLR). Car ce qui passionne Jeff Bezos, c’est de miser sur le long terme. « Je suis un fan de tout ce qui concerne l’avenir », répète-t-il. Ainsi, le fondateur d’Amazon, toujours en contact par e‑mails et par téléconférence avec la direction de son journal, s’est attaché à propulser ce dernier dans l’ère digitale. Il assure même que l’avance technologique du Post tiendrait aujourd’hui la comparaison avec celle de « n’importe quelle entreprise de la Silicon Valley » ! Les résultats, en tout cas, sont là : 76 millions de visiteurs uniques en décembre 2015, selon l’institut de recherche marketing comScore, soit davantage que pour le New York Times, et, sur un an, entre avril 2015 et avril 2016, une hausse de 30 % du nombre de ses visiteurs uniques. Au mois de mars 2016, le nombre de pages vues sur le site du Post a été de 988 millions, contre 811 millions pour le New York Times.


Mais Jeff Bezos a bien d’autres ambitions et assure que s’il a racheté le Post, c’est aussi pour servir partout la démocratie, car ce journal est, selon lui, « un moyen de contrôler les agissements des leaders des pays les plus puissants du monde ». C’est un point de vue que partage évidemment l’actuel Executive Editor, Marty Baron, 62 ans, aux commandes de la rédaction du Post depuis fin 2012. Ce dernier, qui nous a longuement reçus à l’occasion de cette enquête, n’est autre que le journaliste incarné dans le récent film Spotlight, salué par six nominations aux Oscar. C’est lui qui, en avril 2003, a été récompensé par le prix Pulitzer, alors qu’il dirigeait la rédaction du Boston Globe, pour avoir conduit à son terme la fantastique enquête journalistique qui a permis de mettre fin aux agissements d’un tentaculaire réseau de prêtres pédophiles dans le diocèse catholique de Boston. Et cela en dépit de l’omerta des dignitaires locaux de l’Église et des pressions d’un monde politique complice. Alors, comment cet as du journalisme d’investigation ne pourrait-il pas applaudir à cette définition de sa mission de « vigile de la démocratie » que donne Jeff Bezos ? « Nous vivons une époque où, aux États-Unis et partout dans le monde, des hommes et des institutions accumulent de plus en plus de pouvoir, confie Marty Baron. Cela rend indispensable l’existence d’une presse libre et indépendante qui puisse surveiller toute cette puissance. Et, bien sûr, cela inclut le gouvernement, l’Administration, le business en général, y compris celui des médias. Selon moi, c’est la responsabilité du journalisme d’investigation que de surveiller les faits et gestes de tous ces puissants acteurs et, au besoin, de leur réclamer des comptes. » Très attaché aux valeurs de son métier et à sa mission d’investigation, Marty Baron n’en est pas moins impliqué, aux côtés de Jeff Bezos, dans la profonde mutation technologique du Post. Pour s’adapter au nouvel environnement digital, un journal doit, souligne-t-il, « inventer sans cesse », car une édition print et une édition numérique « ne sont pas du tout de même nature » et les réactions des lecteurs vis-à-vis de ces médias sont « totalement différentes ». Marty Baron estime que, non seulement le digital exige qu’on soit plus réactif et plus accessible et qu’on utilise tous les outils de communication dont on dispose – audio, vidéo, animation, etc. –, mais qu’il s’agit aussi, surtout, de faire preuve, sur la Toile, « d’une extrême vigilance à l’égard de ce que dit le lecteur ». Sur ce thème, Jeremy Gilbert, le jeune et enthousiaste directeur des initiatives numériques du Washington Post, est intarissable : « Le dialogue avec nos lecteurs et la parfaite connaissance de ces derniers sont pour nous primordiaux. En effet, chaque journaliste doit savoir ce qui intéresse particulièrement sa communauté de lecteurs, ce qui les fait réagir, combien de temps ils ont consacré à la lecture de telle ou telle information sur leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette. C’est ainsi qu’on peut mieux traiter et mettre en scène les news qui vont les intéresser. »

Vers une offre numérique rentable
Une science presque exacte, en somme, à cela près que les recettes du trafic payant des éditions numériques et de la publicité en ligne restent marginales. « Nous progressons sur le chemin qui nous mènera à un business-modèle rentable, mais nous sommes encore loin du but. Je pense que personne au monde ne peut prétendre avoir déjà trouvé la solution qui garantira le futur de notre profession et de celle de l’industrie de la presse, reconnaît Marty Baron. Aujourd’hui, comme cela est le cas pour presque tous les journaux, la majeure partie de nos revenus provient encore de l’édition papier, même si ceux du digital augmentent. Il faut dire que la plupart de nos lecteurs restent très attachés au journal papier… » Il est vrai que pour seulement 2 dollars en semaine et 3,50 dollars pour l’édition du dimanche, les centaines de milliers de lecteurs du Post en version print (audience de 1 million en semaine et de 1,5 million le week-end, dans la seule région de Washington !) en ont pour leur argent : quotidiennement, le journal leur propose une cinquantaine de pages plus une dizaine dévolues aux petites annonces et, le dimanche, une centaine de pages, dont huit de BD et jeux, plus un magazine de 45 pages. Mais la cerise sur ce généreux gâteau, c’est bien sûr le talent et le charisme de Marty Baron pour guider ses 700 journalistes bimédia afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, notamment en matière d’investigation. Hier, sous sa direction éclairée, le New York Times, le Boston Globe et le Miami Herald ont gagné onze prix Pulitzer. Depuis qu’il l’a rejoint, voilà trois ans seulement, Marty Baron en a déjà ajouté quatre au prestigieux palmarès du quotidien emblématique de Washington !
10 questions à Marty Baron
Executive Editor (directeur de la rédaction)

The Good Life : Comment se passe votre collaboration avec Jeff Bezos ?
Marty baron : Il détient notre groupe de presse et notre journal à 100 %. C’est donc évidemment très important pour toute notre équipe de direction d’entretenir une bonne relation professionnelle avec lui. Ce serait très préjudiciable, très contre‑productif si ce n’était pas le cas. Non seulement nous échangeons des e‑mails et nous nous entretenons avec lui régulièrement au téléphone, mais nous lui rendons également visite à Seattle deux fois par an. Il vient aussi nous voir de temps en temps ici, à Washington, mais il n’a pas pour autant de bureau au siège du journal. Je crois que Jeff Bezos a l’équipe qu’il souhaite, au Post, car si ce n’était pas le cas, il aurait toute latitude pour en changer !
TGL : Financièrement, le Post est‑il bénéficiaire ou déficitaire ?
M. B. : Je ne suis pas autorisé à vous donner des résultats financiers, mais vous pouvez toujours essayer de demander à quelqu’un d’autre… Je suis désolé, je ne peux répondre à cette question. Mais, disons que nous demeurons stables et progressons vers un modèle durable.
TGL : Depuis votre arrivée, vous avez recruté 70 nouveaux journalistes. C’est plutôt bon signe, par les temps qui courent…
M. B. : C’est vrai qu’on a la chance d’être détenus par quelqu’un qui n’hésite pas à investir dans notre journal, dans notre rédaction et dans les moyens techniques afin que nous réussissions notre mutation vers le digital. Mais Jeff Bezos ne nous apporte pas seulement des capitaux, il nous apporte aussi ses idées, car, pour se développer, l’argent ne suffit pas, il faut aussi avoir de bonnes idées.
TGL : La prochaine élection présidentielle américaine va‑t‑elle booster les ventes de l’édition papier ?
M. B. : Non, je ne le pense pas. Car, hélas, plus rien de nos jours ne semble de nature à faire décoller les ventes d’un journal papier…
TGL : Pas même la publication d’un scoop ?
M. B. : Non. [Soupire.] En revanche, sur le digital, le trafic augmente sensiblement dans ce contexte politique aussi important, et c’est pourquoi nous avons renforcé notre dispositif journalistique pour expliquer les enjeux et rendre compte de cette élection capitale. Nous entendons être les meilleurs pour cette couverture journalistique.
TGL : Quel est votre pronostic pour ce scrutin ?
M. B. : Cela s’annonce trop serré pour faire un pronostic. Nous avons eu souvent, aux États‑Unis, ce cas de figure, car notre pays est politiquement très divisé.
TGL : On le voit bien dans le film Spotlight, dont vous êtes le héros. Le journalisme d’investigation est dans votre ADN, mais aussi dans celui du Post, que vous dirigez aujourd’hui. Y a‑t‑il une attente et une exigence particulière de vos lecteurs en ce domaine…
M. B. : Oui, le journalisme d’investigation, c’est vraiment une très longue tradition dans l’histoire du Washington Post… Cela fait partie, comme vous le dites, de notre ADN. Je dirais même que l’investigation c’est « notre » mission. Au Post, nous avons une expertise, un vrai savoir‑faire en matière d’investigation et, au XXIe siècle, c’est un atout capital. Évidemment, cela nous oblige à toujours veiller à garder intacte notre crédibilité.
TGL : Les lanceurs d’alerte sont‑ils importants pour un journaliste ?
M. B. : Ils sont l’une des sources d’information possibles. Ainsi de Deep Throat [Gorge profonde, NDRL] pour l’affaire du Watergate. En revanche, lors du scandale des prêtres pédophiles révélé par le Boston Globe, nous avons déniché notre source nous‑mêmes dans les archives de la Justice. Dans l’affaire Snowden et des révélations du Post sur les écoutes de l’Agence nationale de sécurité (NSA), il ne s’agissait pas exactement d’un lanceur d’alerte, car Edward Snowden était un ancien technicien de la CIA, donc un insider [un initié, de l’intérieur, NDLR].
TGL : Il paraît que vous détestez qu’on emploie certaines expressions, comme « le contenu » (« content ») ou « la marque » (« brand ») à propos d’un journal…Pour quelle raison ?
M. B. : [Sourire.] Parce que j’estime que le mot « contenu » n’a aucun sens ! Cela peut désigner n’importe quoi ! Je préfère le mot « journalisme ». Du « journalisme », c’est en effet bien autre chose que du « contenu », car c’est chercher à savoir : quels sont les faits ? en quelles circonstances ? quelles sont les conséquences ? qui est responsable ? Et tout cela, pour moi, a vraiment du sens. Ce n’est pas seulement remplir de l’espace sur une page de journal ou d’un site web ! Le terme « journalisme », c’est bien plus que du remplissage, c’est une démarche qui consiste à poser des questions, à se poser des questions et à trouver des réponses, c’est une volonté d’approfondir. Il y a une longue tradition du journalisme à laquelle nous devons rester fidèles, mais il n’y a aucune tradition, aucune histoire du « contenu » ; ce terme, comme celui de « marque », n’a pas sa place dans un journal !
TGL : Êtes‑vous confiant dans l’avenir de notre métier ?
M. B. : Je garde espoir et veux rester optimiste. Je suis conscient que nous traversons une période difficile, avec des défis très importants à relever, car la façon dont le public accède à l’information a totalement changé et changera encore.Mais dire que quelque chose est difficile, ce n’est pas dire que c’est impossible à surmonter… Je crois qu’il est essentiel que chacun de nous dans ce métier garde espoir, courage et détermination, afin de continuer de chercher des solutions, d’explorer de nouvelles voies. Mais, surtout, il faut faire tout cela en restant fidèles à nos valeurs, à notre rigueur, à notre professionnalisme.