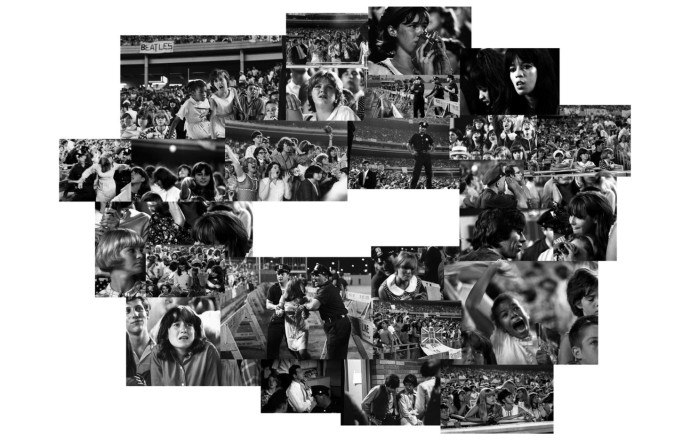- Culture>
- The Good News>
Les Gardiens de la Presse, épisode 3. Alors que The Good Life s’offre un lifting, fidèle à son esprit avant-gardiste tout en captant l’air du temps, nous consacrons une série de cinq articles aux métiers de la presse. Comment vit un journal ? Qui en orchestre le contenu ? Comment ses pages prennent-elles forme ? À l’heure du tout-numérique et face aux défis posés par l’intelligence artificielle, il est plus que jamais essentiel de célébrer une information écrite par et pour des humains.
Qui a déclaré que la curiosité était un vilain défaut ? Sûrement pas le journaliste pour qui la transmission de savoir est ancrée dans leur ADN. Un métier qui a subi de nombreuses transformations, comme en témoignent ces quatre plumes aiguisées rencontrées pour l’occasion.
Lire aussi : À Francfort, l’esprit éclairé de Cai Tore Philippsen
Les gardiens de la presse
La France comptait, en 2023, 34 051 journalistes en activité. Une profession qui, à en croire la Commission de la Carte d’Identité des Journalistes Professionnels, a presque atteint la parité puisqu’elle dénombre 51,6 % d’hommes et 48,1 % de femmes. Ces dernières années, les rédactions ont dû s’adapter aux changements de paradigme de notre société en ajustant leurs contenus éditoriaux autant sur le fond que sur la forme.

Une métamorphose dont a été témoin Sandra Lorenzo, qui exerce aujourd’hui en tant que reporter au quotidien La Provence après avoir passé près de dix ans à la rédaction parisienne du site Huffington Post : « C’est un travail très différent et difficilement comparable. On ne traite pas les sujets de la même manière selon le média dans lequel on exerce, tout simplement car ce n’est pas le même lectorat. »
Elle a su, en intégrant la rédaction du quotidien régional il y a presque deux ans, délaisser les sujets lifestyle et internationaux pour se concentrer sur un territoire défini, ce qui n’est pas pour lui déplaire : « Mon lectorat est local, et cela influence énormément ma manière de chercher et de construire mes sujets, c’est une nouvelle logique à adopter. Au HuffPost, j’avais l’impression de pouvoir traiter une infinité de sujets, avec le risque de m’éparpiller. Ici, l’ancrage local structure mon travail et ma réflexion, cela m’apporte un cadre qui me semble plus stable et plus clair. »

Un cadre qui nécessite de partir à la rencontre des autres, la motivation première pour cette mère de famille qui se réjouit de faire briller ceux et celles qui, bien souvent, ont une parole oubliée, voire confisquée : « Je suis quelqu’un de très curieux, et ce qui me passionne, c’est de comprendre comment les gens vivent au quotidien, avec leurs difficultés, leurs petites victoires, leurs grandes joies. Je n’ai aucune envie d’interviewer des stars ou de courir après les projecteurs. Ce qui m’intéresse, c’est la réalité des gens, ceux qui ne sont pas sous le feu des projecteurs, mais qui ont des parcours riches et des histoires précieuses à partager. Un bon témoignage peut être bien plus percutant qu’une interview d’expert ou qu’un long discours d’un spécialiste. »
Le goût des autres
Un amour de la transmission ancré tout aussi profondément dans les gènes de Nolyne Cerda, journaliste spécialisée dans la beauté qui, depuis près de dix ans, pose sa plume dans les plus grands magazines féminins.

« Pour moi, l’essentiel est de rencontrer des gens et d’échanger avec eux. Cela peut sembler un peu naïf de dire cela, mais c’est vraiment la raison pour laquelle j’ai choisi ce métier : apprendre des choses chaque jour et avoir l’opportunité de discuter aussi bien avec un nez dans la parfumerie qu’avec un scientifique ayant développé une molécule pour une crème. J’ai aussi l’occasion de parler avec des sociologues, des historiens… Journaliste beauté, ce n’est pas juste écrire sur un mascara ou un parfum, c’est réellement aller à la rencontre des personnes qui participent à ce domaine au sens large. »
Une largesse d’esprit qui l’a amenée, en 2020, à créer son propre média, Parlons B, un podcast dédié au monde de la beauté : « La pandémie a affecté mon travail puisque la rédaction dans laquelle je travaillais a fermé. Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé et j’ai eu l’envie, tout comme le besoin, de trouver de nouvelles façons d’exercer mon métier. »
Depuis, celle qui collabore à nouveau avec de nombreux médias apprécie le fait de pouvoir garder son indépendance : « Écrire pour plusieurs médias aux visions variées me permet de travailler avec des personnes très différentes, ce qui est extrêmement enrichissant. »

Une expérience qui, comme tout bon revers de la médaille, a aussi un prix : « C’est néanmoins une liberté qui peut être lourde. En tant que journaliste indépendante, il faut sans cesse aller vers les gens, les solliciter, proposer des sujets. Les budgets alloués aux pigistes se réduisent de plus en plus, tandis que le nombre de journalistes indépendants a explosé depuis le COVID, souvent par nécessité plutôt que par choix. Du coup, les opportunités pour écrire se font de plus en plus rares. » Une rareté qui oblige bon nombre d’autres journalistes à élargir leur champ des possibles.
Couteaux suisses
Reconnu comme journaliste engagé, Anthony Vincent a lui aussi collaboré avec de nombreuses rédactions, du média Madmoizelle au magazine masculin GQ. « J’ai commencé dès le début de ma carrière, il y a dix ans, à m’intéresser aux questions d’identité, un sujet qui me touchait personnellement en tant qu’homme noir et gay. J’ai alors écrit mes premiers articles engagés sur ces thématiques. J’ai eu la chance d’être reconnu et identifié pour ce type de travail. Aujourd’hui encore, on me contacte directement pour traiter de sujets liés au racisme, à l’homophobie et, plus largement, aux discriminations envers les personnes LGBTQ+. C’est un domaine qui me passionne et qui me tient à cœur. »

À regret, il remarque depuis deux ans une baisse d’intérêt des médias pour ces sujets : « La presse traverse une crise économique qui réduit l’espace disponible pour tous types de sujets, en particulier ceux qui sont engagés. Je pense que ces thématiques sont perçues comme moins vendeuses dans le contexte actuel. »
Il décide, lui aussi, de prendre les taureaux par les cornes et de maîtriser son propre destin en enseignant l’écriture et les différentes formes de journalisme au sein d’une école privée : « J’enseigne également des matières liées aux relations presse, au marketing, à la stratégie de communication et au storytelling. »

Une parenthèse qui n’en est pas une, puisque le talentueux trentenaire compte bien se refaire une place au sein d’une rédaction : « Je suis quelqu’un de trop anxieux pour être pigiste ou freelance sur le long terme. Je ne suis pas à l’aise avec l’incertitude permanente qu’implique l’indépendance, je préfère la sécurité du salariat. Je pense qu’on appartient à une génération qui exercera plusieurs métiers au cours d’une vie, à la fois à cause des crises successives que nous avons connues, mais aussi parce que l’idée de passer toute sa carrière dans la même entreprise ne fait plus autant sens qu’avant. Personnellement, ça me convient de me dire que je vais probablement me réinventer trois ou quatre fois dans ma vie, en me réorientant et en me formant à de nouvelles compétences. »
La confiance règne ?
Une réinvention que connaît sur le bout des doigts Sandie Dubois, qui après 18 ans de carrière en tant que journaliste et rédactrice en chef, a été témoin de métamorphoses successives au sein des médias, de l’érosion de la presse papier à l’avènement du 100 % digital.

« J’ai commencé à une période où on ne parlait pas d’influenceuses mais de blogueuses, les magazines consacraient des pages au street style en s’inspirant de ce qu’on pouvait trouver sur les blogs, comme celui de Garance Doré. La période de basculement entre le magazine papier et le web était intéressante car chacun cherchait une façon de se renouveler, on sentait une émulation créative. Mais très vite, le web a participé au déclin de la presse papier qui se trouvait désormais à portée de main dans nos smartphones. Les rédactions ont eu du mal à mettre les moyens nécessaires pour mettre en place de vrais services dédiés à la déclinaison de leur média sur le web. »
Sandie décide, il y a quelques années, d’explorer un autre média, celui de la télévision : « La notion de service public est très importante pour moi, j’ai réalisé des reportages pour Arte et je travaille aujourd’hui sur une autre chaîne, France 5, dans une émission qui parle de l’actualité des territoires outre-mer. Déontologiquement et personnellement, travailler pour ces rédactions donne du sens à mon travail, chose que je ne retrouvais pas toujours dans la presse écrite. »
Lire aussi : Visa pour l’image : quand la photographie décode les maux de notre époque