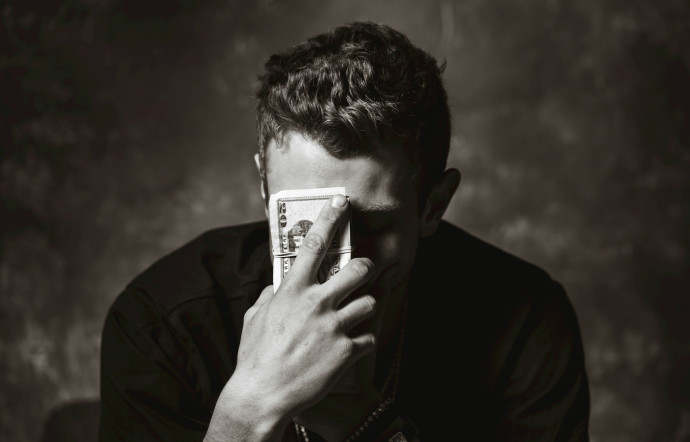The Good Business
Malgré l’influence croissante d’Internet, les Suédois aiment la presse : 84% des plus‐de‐15‐ans lisent un quotidien (ça fait rêver…). Créé en 1830, l’Aftonbladet est le plus lu de toute la Scandinavie. A la fois quotidien d’actu engagé et tabloïd, il fait aussi le grand écart entre le web et le papier. Visite The Good Life dans les locaux de l’un des plus gros titres du pays.
L’Aftonbladet en chiffres
- Création : 6 décembre 1830.
- Fondateur : Lars Johan Hierta.
- Actionnaires : groupe de presse norvégien Schibsted (91%) et LO, confédération suédoise des syndicats (9%).
- Périodicité : quotidien.
- Diffusion : 154000 exemplaires.
- Parutions hebdomadaires : Wellness (magazine santé), Klick ! (people), Härligt Hemma (décoration), Kryss & Quiz (famille).
- 250 journalistes dont 235 basés à Stockholm et des correspondants aux États-Unis, en Angleterre et en France.
L’Aftonbladet digital en chiffres
(Internet et applications pour tablettes et smartphones).
- 100 000 clics pour un article politique au moment des élections.
- 3,2 millions de visiteurs uniques par jour.
- 69 millions d’euros de revenus publicitaires on-line.
- 8 millions d’euros de revenus en abonnements on-line.
- 205 000 lecteurs payants pour Aftonbladet Plus.
Porté depuis cent quatre-vingt-cinq ans par cet appétit d’information et caracolant en tête des journaux scandinaves, le très populaire quotidien Aftonbladet (« la feuille du soir ») veut toujours croire à des lendemains qui chantent, malgré la baisse conjuguée de sa diffusion papier et de ses recettes publicitaires.
C’est donc essentiellement sur Internet que le journal entend désormais consolider sa position de leader. Paradoxalement, au cœur de cette Suède si riche en forêts et en usines de pâte à papier, il a même été l’un des tout premiers quotidiens du monde à opter, dès 1994, pour le « on line first ». Aujourd’hui, tous les articles de l’Aftonbladet sont d’abord conçus et écrits pour le site Internet du quotidien, puis éventuellement « rewrités » pour l’édition papier.
Exactement l’inverse de ce qui se passe en France, en somme…
Une succession de virages politiques
« Nous n’étions pas des “fossoyeurs du papier”, comme certains nous ont qualifiés, mais des pionniers, des visionnaires », insiste Jan Helin, 47 ans, l’actuel directeur de rédaction qui doit son physique athlétique à une longue pratique du canoë et du cyclisme. Ce virage, presque à 180 degrés, n’était pourtant que l’un des derniers avatars d’une très longue épopée médiatique. Parce que, à l’époque où l’ancien maréchal de Napoléon Ier, le Béarnais Jean‐Baptiste Bernadotte, régnait sur la Suède sous le nom de Charles XIV, la « feuille du soir » prenait déjà son envol à Stockholm.
Choqué par le ton irrévérencieux de ce nouveau journal, le roi l’interdira une première fois. Il reparaîtra ensuite sous le nom de Det Andra Aftonbladet (« le second Aftonbladet »), puis sera rebaptisé vingt‐six autres fois tout au long de ce régime monarchique particulièrement sourcilleux à l’égard de la presse.
L’Aftonbladet n’était pourtant pas au bout de ses métamorphoses. A l’origine libéral, alors que la Suède se modernise, il se fait conservateur à la fin du XIXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement allemand prend secrètement le contrôle de son capital, puis, dans les années 30, devenu propriété de la famille d’industriels suédois Kreuger – qui fabrique notamment les fameuses allumettes suédoises –, il s’affiche « politiquement neutre ».
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le voilà proallemand, sous l’influence de nombre de ses employés. En 1956, le groupe Kreuger crée la surprise en vendant ses actions à la confédération suédoise des syndicats (LO), le reste du capital étant détenu, depuis 1996, par le groupe de presse norvégien Schibsted, l’un des pionniers européens de la transformation numérique des médias et du quotidien gratuit – il a lancé 20 Minutes en France, en Espagne et à Zurich.
Depuis 2009, l’Aftonbladet est détenu à 91% par Schibsted et à 9% par LO et se proclame aujourd’hui social‐démocrate indépendant. « Notre actionnaire LO a certes un droit de veto sur la nomination du rédacteur en chef politique, mais elle n’en fait pas usage », assure Lena Mellin, qui dirigea le service politique du quotidien pendant vingt‐cinq ans et qui assiste aujourd’hui le directeur de la rédaction. Elle ajoute d’une voix autoritaire : « Heureusement, il n’existe pas de veto sur le contenu des articles, car ce serait un scandale ! Nous veillons par ailleurs à ne jamais mélanger l’information sur les faits et les commentaires. Ceux-ci sont réservés aux pages éditoriales, très distinctes des pages news. »
Des commentaires journalistiques au demeurant souvent acerbes, comme ces attaques virulentes, dans les années 90, contre les essais nucléaires français ou contre Nicolas Sarkozy, sous la plume de l’éditorialiste d’alors, Olle Svenning.