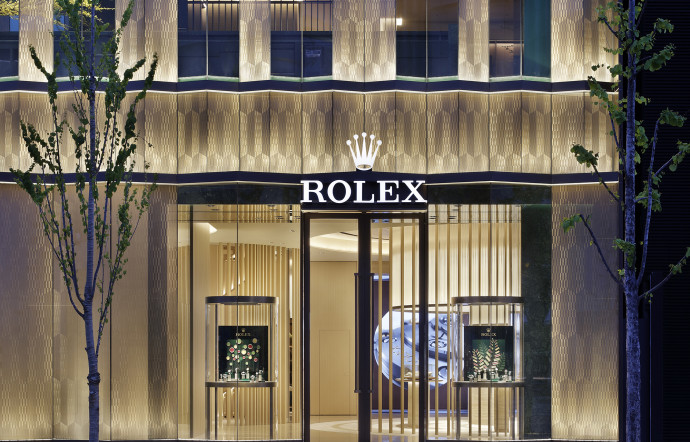- Architecture>
Indissociable de la République de Weimar, ce mouvement artistique entendait révolutionner l’enseignement des arts et s’inscrire dans une modernité libérale et sociale. Préfigurant le modernisme architectural, les idées du Bauhaus seront néanmoins une cible pour l’extrême droite alors montante.
Au sortir de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne, ruinée financièrement, vit de profonds troubles politiques. Des cendres de l’empire vaincu va naître un nouveau régime, la République de Weimar, proclamée par les députés le 31 juillet 1919 dans le Théâtre national de cette ville de province réputée sûre. Weimar est en Allemagne une caution morale et culturelle, la « Ville des poètes et des penseurs », incarnant « l’esprit allemand » depuis le XVIIIe siècle. C’est précisément ici qu’ont vécu autrefois de grands artistes et intellectuels, parmi lesquels Goethe, Schiller, Bach, Nietzsche, Schopenhauer ou encore Liszt. La jeune démocratie parlementaire dirigée par le socialiste Friedrich Ebert contredit l’esprit autoritaire des Kaisers déchus. La Constitution prône un libéralisme absolu, la liberté de la presse et le droit de vote des femmes, accordé en 1919. Si la pauvreté règne en masse dans le pays, Berlin et les milieux éclairés vivent leurs Goldenes Zwanziger, leurs années folles. Et voilà que le Bauhaus débarque dans tout ça.
Lire aussi : Flaine, l’utopie moderniste au cœur des Alpes françaises
Bauhaus : l’utopie de l’art communautaire
Un préambule est nécessaire pour comprendre l’esprit Bauhaus. Un mouvement artistique indissociable de ce contexte politique qui naît cette même année 1919 lorsque l’architecte d’avant-garde Walter Gropius s’installe dans cette petite ville pour créer une nouvelle école d’État.
Gropius ambitionne « d’abattre le mur d’orgueil séparant artistes et artisans ». Il veut rompre avec les styles germaniques et marquer l’époque avec un nouvel apprentissage des arts. En architecture surtout, il s’agit d’épurer les formes, de standardiser, d’utiliser de nouveaux matériaux comme le béton et le verre, d’ériger des immeubles fonctionnels aux formes géométriques simples sans ornement aucun.
Les cours commencent le 1er octobre. Céramique, sculpture, peinture, photo, théâtre, danse… l’école du Bauhaus se veut multidisciplinaire. Des professeurs parfois connus donnent cours, tels que les artistes Klee, Schlemmer ou Kandinsky, dans une approche désormais démocratique de l’art. Elle repose avant tout sur une utopie, celle de l’art communautaire et du Lebensreformbewegung, mouvement socioculturel qui prône un mode de vie proche de la nature. Certains étudiants – et parfois leurs encadrants – pratiquent l’amour libre, dansent nus. On voue un culte à l’homme nouveau, un être pur universel, dénominateur de l’humanité entière.
Une portée sociale et politique
C’est également par sa dimension sociale que le Bauhaus est novateur. L’industrialisation et la préfabrication font baisser les coûts de construction et rendent les logements plus abordables. L’école entend s’adresser à toutes les classes sociales, faire entrer des œuvres d’art ou d’artisanat dans la vie quotidienne des foyers. Certaines pièces de mobilier produites deviennent de véritables icônes, à l’image de la chaise basse de Marcel Breuer conçue en 1926 ou bien de la lampe Wagenfeld en 1924, remarquable par ses lignes épurées. Ou encore de la vaisselle en verre transparent produite pour amener plus de légèreté dans les ménages, dans une ode aux lumières de la raison. Ce fonctionnalisme nouveau a bien évidemment une portée politique : faire gagner du temps à la femme pour qu’elle s’instruise et s’intéresse à la vie publique.

(chaise à lattes) par Marcel Breuer.
Les conservateurs s’agacent de l’aspect démocratique de cette arrogante clique d’artistes. Notamment la petite aristocratie de Weimar, qui vivait avant-guerre d’un système féodal et se retrouve dans cette République sans ressource. La sobriété du style Bauhaus et sa modernité attirent l’ire des conservateurs. Inhérente au régime politique en place – de plus en plus contesté –, l’école symbolise une certaine décadence des mœurs. Et Weimar, caution culturelle de l’Allemagne, devient un enjeu pour les nationaux-socialistes. Lorsque les conservateurs gagnent les élections régionales en 1925, l’école se voit contrainte de déménager une première fois dans la ville de Dessau. Mais encore une fois, l’extrême droite gagnant du terrain, elle s’établira à Berlin en 1932 pour une seule année, avec un dernier directeur, Ludwig Mies van der Rohe, avant d’être dissoute pour motif d’« art dégénéré ».
Mais avec l’exil de ses membres, les idées du Bauhaus se répandent à travers le monde entier, en particulier aux États-Unis. Gropius y prend la tête de l’école de design d’Harvard et Ludwig Mies van der Rohe celle de l’école d’architecture de Chicago, qui contribue à l’apparition des premiers gratte-ciel. Car le courant Bauhaus préfigure le modernisme architectural. C’est aussi cette idée nouvelle qui veut qu’un objet peut être simple et fonctionnel mais aussi esthétique et accessible. L’enseigne IKEA en est certainement aujourd’hui la grande héritière.
Que devient Weimar ?
Malheureusement, la ville est, durant la période nazie, entachée par les atrocités du camp voisin de Buchenwald, qui verra 250 000 personnes détenues pendant la guerre. Bombardée par les Américains, pour le symbole qu’elle représente, la ville sera par la suite négligée par la RDA qui laissera son patrimoine dépérir.
Aujourd’hui, Weimar vit comme une renaissance. Sa réputation de petite capitale culturelle n’est absolument pas galvaudée, de nombreuses institutions en sont la caution. Une partie de la population renie toutefois la République qui a conféré à son nom une réputation mondiale, car ce régime a longtemps été considéré, par sa faiblesse et son manque de vision, comme la principale raison de la prise du pouvoir du parti nazi, de la guerre et de la destruction du pays.
Un nouveau musée consacré au Bauhaus a été inauguré en 2019, loin de faire l’unanimité. Située dans l’ancienne Allemagne de l’Est communiste, où l’art abstrait était interdit, le Bauhaus peut être perçu encore aujourd’hui par certains comme une incongruité. Aujourd’hui, la région est un bastion du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD), dont les responsables ont publiquement dénigré cet héritage, qualifiant le mouvement Bauhaus de « dérive de la modernité », l’accusant de « violer le besoin humain de convivialité », évoquant au passage les constructions HLM – héritières de ce mouvement architectural – dont les populations bien souvent immigrées sont dans le viseur du parti extrémiste.
S’il fallait démontrer que l’histoire se rejoue…

Quelques lieux d’importance à Weimar
Le musée Bauhaus
Ouvert à Weimar en 2019, le musée fait un pont entre l’histoire de l’école du Bauhaus et des questions sociétales contemporaines. L’architecte Heike Hanada a imaginé un vaste cube gris au design minimaliste, selon la doctrine de l’école. Actuellement, l’exposition « Bauhaus et le national-socialisme » revient sur l’histoire politique du mouvement, brossant un portrait plus nuancé des étudiants du Bauhaus et proposant une analyse approfondie de la relation complexe entre d’anciens membres et le régime nazi.
Stéphane-Hessel-Platz 1, 99423 Weimar, Allemagne
Haus Am Horn
Seule architecture Bauhaus réalisée à Weimar – par Georg Muche – cette maison modèle a été construite en 1923 à l’occasion de la première grande exposition Bauhaus. D’une incroyable modernité pour l’époque, ce prototype d’habitat blanc au toit plat comprend de grandes ouvertures vitrées, exposant les principes fonctionnalistes du mouvement. La Haus Am Horn est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Am Horn 61, 99425 Weimar, Allemagne

Bâtiment du Bauhaus de Dessau
Après son déménagement à Dessau en 1925, le Bauhaus inaugure en 1926 cette université emblématique, s’offrant là un bâtiment qui réunit les conditions idéales pour ses étudiants. Son mur-rideau en verre suspendu en fait une icône du modernisme. Vingt-huit studios de 20 m², destinés aux étudiants de l’école, sont répartis sur une aile du bâtiment, ponctuée de longs balcons. À l’intérieur, un code couleur identifie les différents éléments porteurs. L’ensemble est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1972.
Gropiusallee 38, 06846 Dessau-Roßlau, Allemagne

La cité Törten
Situé dans la ville de Dessau, le domaine de Törten comprend 314 maisons mitoyennes lumineuses, construites à partir de 1926. Le Bauhaus a imaginé ce nouveau quartier comme une réponse économique au besoin de logements de masse, une problématique cruciale dans la République de Weimar.
Mittelbreite 4, 06849 Dessau-Roßlau, Allemagne
Lire aussi : La curieuse histoire de l’île de Heligoland, en Allemagne