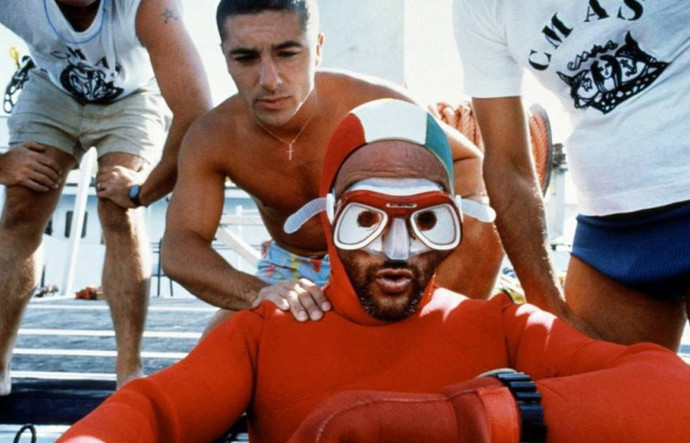- Horlogerie>
À El Alto, en Bolivie, l'architecte Freddy Mamani rend hommage, à travers son œuvre, à sa culture aymara. Autodidacte, il s’est fait connaître en concevant plus d’une centaine de bâtiments qui redonnent son identité et sa fierté à sa ville, l’une des plus hautes du monde, et à toute une population.

Freddy Mamani est sur ses gardes. Il se méfie des journalistes. Ces dernières années, il regrette la parution d’un certain nombre d’articles superficiels, célébrant une vision esthétisante de son travail haut en couleur, sans se soucier ni de son inspiration – la culture aymara – ni des conditions socio-économiques dans son pays, la Bolivie, le plus pauvre d’Amérique du Sud. Ainsi, son œuvre passerait pour une curiosité folklorique et photogénique, ce qu’il déplore. The Good Life signe son portrait.
Né dans le village rural de Catavi, il est l’aîné d’une fratrie de six enfants. « J’ai grandi de façon très heureuse, mais avec les limites imposées par la vie des hauts plateaux. » La famille décide alors de migrer vers des contrées plus urbaines, à El Alto, l’une des villes les plus hautes du monde.
Il juge ses études « européanisées », trop éloignées de sa culture
Ici, Freddy Mamani fréquente l’école, mais parfait aussi son apprentissage du monde de la construction car, à 13 ans, il commence à travailler avec son père comme aide-maçon : « Un travail très dur qui est généralement effectué par des enfants », se souvient-il. « À partir de cet âge-là, j’ai progressivement gravi les échelons jusqu’à pouvoir étudier à l’université et commencer à concevoir et à construire. »

Des études qu’il juge « européanisées », trop éloignées de sa culture. C’est donc sur le terrain qu’il apprend son métier et comment édifier un bâtiment. Autodidacte, Freddy Mamani n’a pas le diplôme d’architecte, mais son œuvre contribue à métamorphoser El Alto, autrefois banlieue-dortoir de la capitale bolivienne La Paz. Il est guidé par l’impérieux désir de faire voler en éclats l’image de cette ville morne et grisâtre, en proie à une forte croissance.
« J’ai toujours eu une vocation pour devenir architecte et pour construire. J’ai également décidé d’exercer ce métier parce qu’El Alto n’avait pas d’identité architecturale. Cette ville grandit très vite, et je souhaitais renouer avec l’identité de notre peuple à travers l’architecture. Je trouvais qu’El Alto était délaissée, alors j’ai voulu lui redonner des couleurs », précise l’artiste, qui conçoit sa première réalisation en 2002. La question culturelle est fortement ancrée chez Freddy Mamani.

En 2006, Evo Morales, lui-même issu du peuple aymara, est élu à la tête du pays avec un programme très social, et c’est la première fois dans l’histoire de la Bolivie qu’un indigène devient président. Icône de la gauche sud-américaine, Morales incarne le renouveau amérindien, assurant la fierté de toute une population et la reconnaissance d’une d’identité et d’une culture qui disparaissaient progressivement. Ce contexte favorable facilite la pleine expression artistique de Freddy Mamani.
La culture Aymara
Au cœur de l’Amérique du Sud, la Bolivie compte près de 12 millions d’habitants et reconnaît, en plus de l’espagnol, 36 langues officielles parlées par 40 groupes ethno‑linguistiques. Issus des hauts plateaux andins, les Aymaras constituent la population, amérindienne, majoritaire à El Alto, ville située à 4 150 mètres d’altitude dans le prolongement de La Paz. Longtemps assignée au statut de banlieue‑dortoir, la cité affirme depuis plusieurs années son identité culturelle, comme en témoigne le travail de Freddy Mamani, malgré un taux de pauvreté toujours très élevé.
Tons vifs et motifs géométriques
L’usage intense qu’il fait des couleurs vives et des motifs géométriques, inspiré par les textiles de ses ancêtres, n’est pas une fantaisie, mais un hommage appuyé à sa culture aymara. Freddy Mamani, dont El Alto devient le terrain d’expression favori, propose une architecture aymara urbaine, immédiatement reconnaissable, et qu’il qualifie de néo-andine. Depuis ses débuts, il a livré plus d’une centaine de ses bâtiments si insolites et a d’ailleurs inventé un nouveau type architectural : le cholet.
Ses édifices tranchent avec le bâti, froid et monochrome d’El Alto

Chacun des projets de Freddy Mamani s’opère en deux étapes distinctes. D’abord, la structure porteuse de l’édifice, en béton et brique, puis l’ornementation et la décoration, qu’il effectue in situ, comme un peintre s’attaquerait à une toile blanche. Ses édifices rebelles tranchent avec le bâti, froid et monochrome d’El Alto. Ils happent le regard et interpellent. D’ailleurs, à la fin de 2018, la fondation Cartier consacre le travail de Freddy Mamani et lui accorde une place majeure dans son exposition Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu : s’y dresse une réplique de ses incroyables salles de bal.
Le «cholet»
Freddy Mamani a inventé un type de bâtiment : le cholet (dérivé de chalet et de cholo, terme désignant péjorativement les habitants de l’Altiplano) repose sur une superposition précise de fonctions différentes. Le rez-de-chaussée accueille des commerces, restaurants ou salles de sport ; une salle de bal aux premier (piste de danse) et deuxième étage (balcons en mezzanine), plusieurs niveaux de logements et, au sommet, une habitation plus luxueuse (le chalet), réservée aux propriétaires issus de la nouvelle bourgeoisie aymara. Cette construction singulière présente la particularité d’être autofinancée, engendrant ses propres revenus locatifs. Un modèle qui a largement fait ses preuves, puisque Freddy Mamani en a construit plus d’une centaine à El Alto, mais aussi dans d’autres villes de Bolivie.

« Il est difficile d’imaginer ma vie sans architecture et sans construction », confie celui qui vient tout juste de fêter ses 50 ans. Inspiré par ses ancêtres, l’artiste est l’architecte de la réconciliation, celui qui sait valoriser « une population majoritaire oubliée et marginalisée » et un pays qui, comme beaucoup d’autres, affronte tant bien que mal la mondialisation.
4 questions à Freddy Mamani - Architecte.

Quelles sont vos principales sources d’inspiration ?
Je suis très inspiré par les ruines de Tiwanaku et de Pumapunku, en Bolivie. Ce sont des sites archéologiques très anciens qui ont une grande importance dans notre société, car ils reflètent notre histoire et notre passé. Les formes des constructions et l’iconographie de ces bâtiments sont, sans aucun doute, une source d’inspiration dans mon travail. Les textiles et les couleurs des matières des tisserands montagnards sont également des références très importantes – des couleurs vives et le maniement de très belles formes –, de même que la nature, les fleurs, les animaux, les oiseaux.
Quel est l’objectif du travail que vous menez dans votre ville d’El Alto ?
En tant qu’architecte, mon but est de laisser ici un héritage. J’aime travailler à El Alto et je suis fier que mon œuvre lui ait donné cette identité que j’ai toujours recherchée. Dans le passé, El Alto se développait sans aucun paramètre de couleur ou de forme ; comme c’est une cité prospère, les gens ont une façon particulière d’aborder la question du logement.
Comment résumeriez-vous la philosophie de votre travail ?
Il s’agit, pour moi, de représenter une culture à travers les œuvres que je construis, des œuvres qui ont un langage et une raison d’être. J’aime à penser que j’aide la ville et ses habitants, tout en inspirant la nouvelle génération d’architectes d’El Alto. Nous essayons également d’épauler les personnes qui ont besoin de soutien pour se lever et aller de l’avant.
Dans ce monde globalisé, quel est selon vous l’avenir de l’architecture ?
L’avenir de l’architecture repose sur l’évolution et la dynamique de ses habitants en fonction de leur culture, et sur l’interprétation de ce qu’est la modernité dans chaque région. J’espère que le style sur lequel nous travaillons ici s’enracinera ailleurs. J’espère également que d’autres architectes prendront des initiatives et pourront évoluer avec le style de la ville.
À lire aussi