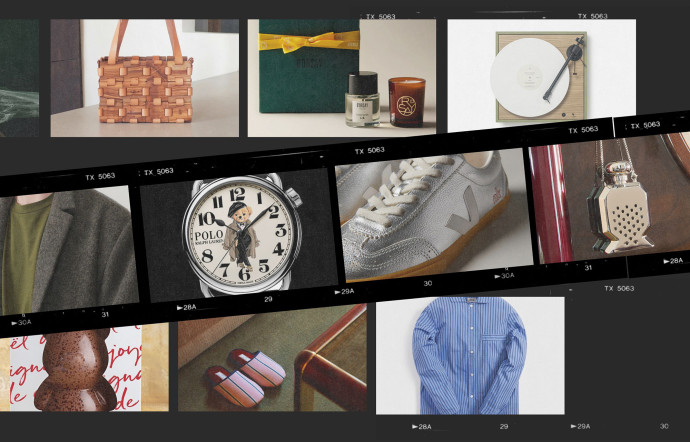- Lifestyle>
Le vêtement de travail, bien coupé, confortable et impeccable passe de l’usine et des champs à la ville. Il incarne la nouvelle durabilité et, en style comme en matières, un made in France que le monde entier nous envie.
Quel paradoxe ! Au moment où le télétravail devient la norme, les cadres lâchent le costume pour enfiler un uniforme sans lien avec leur milieu BCBG : la veste d’ajusteur, la combinaison de garagiste, la salopette de charpentier… Le vêtement de travail sortent des surplus de l’histoire ouvrière et deviennent des pièces fashion.
Si on l’a déjà beaucoup vu, l’été dernier au masculin, entre autres, chez Zegna et chez Louis Vuitton, au féminin chez Dior, et si ce workwear a toujours inspiré les créateurs, de Chanel à Jean Paul Gaultier, il ne faut pas s’y tromper, son renouveau est bien plus sociétal que modeux. « Après cette longue période où nous nous sommes sentis vulnérables, nous magnifions ce que nous avons eu l’impression de perdre, de ne plus avoir, comme le travail, explique Luca Marchetti, brand expert de l’agence The Prospectivists. Ce vêtement, qui est d’ordinaire porté par une population plutôt humble, incarne les valeurs de simplicité et de durabilité qui agitent aujourd’hui notre inconscient collectif. Il ne s’agit pas d’une réaction conjoncturelle, mais d’une véritable mutation de notre société. »
Le vêtement de travail marque la fin d’une certaine industrialisation de la mode, de la fast fashion.
Avec le workwear, c’est tout un savoir-faire laissé pour compte qui prend sa revanche. Il est apparu dans l’histoire du costume à la fin du XIXe siècle. Aux États‑Unis, impossible de ne pas citer le jean qui, avant de devenir un basique du vestiaire, a été la culotte des chercheurs d’or et des gardiens de bétail. Ses surpiqûres comme ses rivets n’étaient pas là pour le chic, mais pour la solidité.
Timberland a commencé par chausser les bûcherons de l’Oregon et du Montana. Carhartt et Caterpillar habillaient les chantiers de construction bien avant d’être détournés, comme l’a été la chemise de trappeur par le mouvement grunge. En Angleterre, les Dr. Martens sont descendues dans les galeries charbonneuses aux pieds des mineurs et sont passées à la notoriété grâce aux punks. À son tour, le mouvement hipster les a récupérées pour inaugurer une allure cool, outdoor.
Kidur et Le Mont St Michel, la renaissance du vêtement de travail
Elle laisse aujourd’hui la place à une autre authenticité empreinte de durabilité. Et la durabilité, c’est justement ce qui définit une veste ou un pantalon de travail. Preuve en est avec… Kidur. Fondée en 1927 dans les Deux-Sèvres, Kidur produit des vêtements « pour le travail de l’usine et des champs, qui résistent à l’usure ».

- Lire aussi : Kidur, la renaissance du workwear made in France
Dans les années 60, plus de 600 000 pièces sortent de ses ateliers chaque année. Repris en 2018 par Alexandre Clary, le label qui multiplie les collaborations, notamment avec SuperStitch, incarne, comme Le Mont St Michel et Le Minor, la déstandardisation de cette culture textile.
Si on connaît les lainages confortables du Mont St Michel, on sait moins que cette entreprise rachetée par Alexandre Milan en 1998, et enrichie du savoir- faire familial des Tricotages de l’Aa, est spécialisée dans la veste de travail depuis 1913. « Cette veste témoigne d’une époque et d’une culture rurale populaires disparues – que les nouvelles générations ne connaissent que par le cinéma, par des films inspirants comme Alexandre le bienheureux, d’Yves Robert –, mais a toujours eu une clientèle de fins connaisseurs et amateurs grâce à sa moleskine », précise Alexandre Milan.
Contrairement, par exemple, au jean américain très bon marché, la moleskine française a une qualité dite supérieure, souvent imitée, mais jamais égalée. Du coup, les pièces fabriquées par Le Mont St Michel dans ce tissu sont recherchées en Corée comme au Japon et sont cotées au marché vintage.

C’est d’ailleurs ce qui a permis au label, jusqu’à son rachat, de ne pas déposer le bilan. Les ventes de ce monoproduit représentent toujours la moitié du chiffre d’affaires. Outre ses couleurs et ses tissages de saison, elle n’a fait qu’une concession à son passé, sur le taillage. Les silhouettes actuelles sont plus grandes, moins trapues que celles de Jean Gabin dans Le jour se lève, de Marcel Carné, ou de Julien Carette, le garde-chasse de La Règle du jeu, de Jean Renoir.
Le Minor et son pull marin
Le Minor est spécialiste d’un vêtement non pas de terre, mais de mer, comme le pull marin ou le kabig, qui ont habillé les pêcheurs d’Islande chers à Pierre Loti ainsi que la Marine nationale. Le Minor est la bonneterie française la plus ancienne en activité. Si la France l’a longtemps boudée, c’est grâce au Japon, où elle aussi est culte, considérée comme une grande marque de luxe, qu’elle a tenu le choc au cours de décennies difficiles, y réalisant jusqu’à 80 % de ses ventes.

Quand Jérôme Permingeat et Sylvain Flet la rachètent en 2018, ils découvrent un outil industriel incroyable, des machines qui permettent des tricotages particuliers, comme le remaillage. Ils donnent à leurs pulls leur esthétique, leur solidité, ainsi que de très belles finitions.
« Comme la marque avait disparu des écrans radars, il a fallu non seulement former de nouvelles équipes à la production, mais aussi se faire une place dans les vestiaires sans renier nos racines », commente Sylvain Flet. D’où ses collections néoclassiques, singulières et fortes, ancrées dans la Bretagne. D’où, cet hiver, le retour du petit bonnet de goémonier qui s’impose comme une pièce phare de la saison.
3 questions à Alexandre Rousseau, cofondateur de Bleu de Chauffe.
Avec non seulement sa sacoche, mais aussi sa gibecière et sa besace, Bleu de Chauffe fait figure de précurseur du mouvement durable et responsable. Depuis 2009, ce label ancré dans le terroir aveyronnais œuvre à mettre la maroquinerie à l’heure de son époque.

Qu’est‑ce qui vous a incité à fonder Bleu de Chauffe ? Avec mon associé, Thierry Batteux, nous venions du sportswear fabriqué en Asie. Nous avions envie de revenir à des produits plus simples, plus locaux. À l’époque, on ne parlait pas de fabrication française, mais comme nous étions des passionnés du workwear, que nous achetions tous les vieux sacs de métier, nous avons décidé de faire ce qui nous plaisait à notre manière. Peu à peu, une communauté s’est créée.
Dix ans plus tard, où en êtes‑vous ? Nous avons réussi notre pari et sommes entrés dans une autre galaxie. Si, au départ, nous avions une dizaine de références de sacs, nous en produisons plus d’une centaine. Elles sont distribuées en France, mais aussi en Angleterre, aux États‑Unis, et la Chine est devenue, malgré la crise du Covid, notre deuxième marché. Elle est le moteur de notre croissance avec la France. Il y a, là-bas, de vrais connaisseurs du workwear.
Vous êtes ancré en Aveyron. Pourquoi le bout du monde ? Il y a là un savoir‑faire, un écosystème qui, à un moment de l’histoire, a vacillé, qu’on a souhaité pérenniser. Nous avons trouvé des partenaires qui ont joué le jeu. L’économie circulaire a toujours été notre méthodologie de travail. 100 % de nos cuirs sont tannés végétalement. Nos matériaux sont biosourcés et écoresponsables. L’eau que nous utilisons est décantée, traitée et rendue aussi pure qu’avant usage. Quant à notre outil de fabrication, son empreinte écologique préserve la nature environnante.
Lire aussi
Kidur, la renaissance du workwear made in France
Mode et ski : Sur les pistes avec style en 6 marques françaises