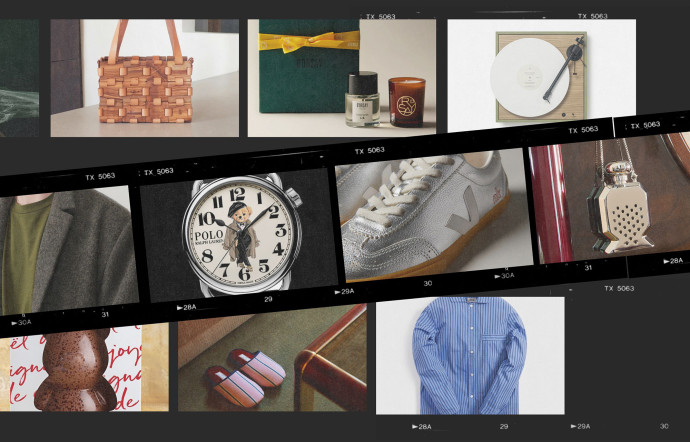- Lifestyle>
Deux familles travaillent ensemble dans un étonnant aller-retour France-Angleterre afin de fabriquer des souliers pour homme, à la main... comme au XIXème siècle. Visite de l'usine à Rushden avec The Good Life.
La manufacture crée les collections Alfred Sargent et Bowen, mais aussi celles d’une quarantaine de labels comme Ralph Lauren ou Brooks Brothers. « Nous produisons entre 500 et 700 paires de chaussures par semaine. Bowen représente la moitié de la production. On aimerait qu’à terme Alfred Sargent et les marques clientes se partagent l’autre moitié à égalité. Pour nous développer à l’international, il faudrait produire plus… et trouver les gens pour le faire », confie Nicolas Thierry, qui nous entraîne vers le département des cuirs. Veau lisse, velours ou grené forment le gros du troupeau. Antilope, cheval, requin, et peaux sauvages du tanneur allemand Weinheimer servent à confectionner les pièces uniques. « Aujourd’hui, les bêtes grandissent vite, les cuirs sont plus fins. Veines et rides sont visibles, comme le fer de marquage, qui doit être vu d’avion pour repérer le troupeau. Ces défauts sautent aux yeux lorsque nous tirons la peau sur la forme. Donc, en taillant une paire dans une seule pièce de cuir – le fameux all-cut si prisé des connaisseurs –, on doit ruser pour que pieds gauche et droit soient identiques », indique le maître peaussier.

Après le choix des peaux, place à la coupe via une collection de couteaux ayant tous une fonction précise (chacun, unique, vaut 2 300 € ). Mais le coupeur, formé durant cinq ans, pose d’abord sur le cuir l’un des 2 366 patrons en épais carton renforcé de laiton (parmi 8 028 archivés). Chaque carton représente l’une des parties d’un modèle et sera détouré avec le couteau – les plus complexes comportent jusqu’à 32 patrons. Ainsi, comme au XIXème siècle, chaque poste est hyper-spécialisé. Munie d’un stylo à encre noire, Shirley inscrit, sur le cartouche de cuir apposé dans la chaussure, nom du modèle, numéros de forme et de série, taille et même le prestigieux « made in England ». Parfois, elle y ajoute une dédicace, dont ce mignon « With all my love ». A côté d’elle, une dizaine de couturières cousent 50 tiges de cuir en trois heures sur des machines Mitsubishi antédiluviennes. « Certaines datent de la Seconde Guerre mondiale et ne sont plus fabriquées. Nous devons réparer nous-mêmes, voire recréer des pièces cassées. Notre métier de bottier est un art assisté par les machines, mais nous sommes une manufacture, pas une usine », martèle Paul Sargent. La preuve dans l’espace de mise en forme, où Graham, troisième génération chez Alfred Sargent, rattache à la semelle intérieure et à la doublure cette tige reçue des couturières. Un collage temporaire maintient l’ensemble avant d’y poser à la main agrafes et petits clous. « L’ancienne manière était de clouer puis de tourner un fil en laiton tout autour. Nous le faisons toujours pour les modèles les plus onéreux », précise Paul.

Atelier foutraque et management cartésien
Contre vents et marées, les frères Sargent font perdurer cette idée presque aristocratique du métier de bottier. Ce perfectionnisme les a conduits à accepter des commandes chères à prototyper, réalisées en petites quantités. Une exigence qui a fini par plomber les comptes jusqu’à ce que ManBow intervienne. Il est fascinant d’observer l’atmosphère passionnée qui règne dans l’atelier graisseux, foutraque et vieillot, où les expressions « rationalisation de la production » et « modèle économique » n’ont aucune prise. Dans le respect de ses partenaires anglais, en usant de trésors de diplomatie, Nicolas Thierry distille un management plus cartésien, une production maîtrisée et une nouvelle organisation : « Depuis que nous sommes partenaires, les réglages des nouveautés se succèdent par petites touches. Nous les avons fluidifiés en maîtrisant les quantités. Si on produit tout de suite en volume, il n’est pas possible d’ajuster des corrections lorsqu’on découvre d’éventuels défauts. »

Happy Goodyear !
Justement, dans un angle de la manufacture se nichent les miniséries. « Ici, on est à un cheveu du sur-mesure, dit encore Nicolas Thierry. Cette zone spéciale évite de stopper toutes les machines juste pour l’élaboration d’une série limitée. On y répare également les souliers de nos clients mieux que n’importe quel cordonnier. » Le temps s’y écoule aussi plus lentement : 20 paires par heure sont détendues à la vapeur, puis séchées sur un étendoir en fer centenaire et tapotées avec un marteau plat aux coutures. Ensuite, un ruban arme les bords de la semelle. Ben, 16 ans, incarne la relève, et c’est lui qui s’y colle. Enfin, toutes les chaussures se retrouvent à l’étape Goodyear.
Les aficionados connaissent bien ce montage si spécifiquement anglais : une pièce de cuir cousue à l’horizontale de manière invisible sur la tige (haut du soulier) et la semelle, tandis qu’un petit point vertical et visible solidifie le tout. Ainsi, la chaussure se bonifie et se patine avec le temps grâce à ces points en fil de Nylon, enduit d’une huile qui ne sert à rien. « C’est uniquement par tradition. Autrefois, l’huile pénétrait le fil en lin, que le Nylon a remplacé », murmure Paul. C’est l’instant où une main ajoute sans trembler les cambrures en bois de bouleau sous la semelle et vient greffer au fond un coussin de granulats de liège pris dans de la colle. « Ce coussin donne l’élasticité, tout comme le feutre de confort ajouté. On laisse sécher vingt minutes, on colle et on cloue la semelle avant de dégrossir les bords », explique Paul Sargent, affairé à une démonstration. Le talon sera lui aussi clouté pour ne jamais vriller, puis poncé. Un cireur va foncer les aspérités, tandis que Janet, elle, nettoie les scories qui dépassent. C’est tout ? Que nenni. Les bords extérieurs de la semelle sont encore lissés, affinés, et reçoivent un coup de noir au pinceau et un polissage à l’huile. Tout comme le dessous, foncé ou éclairci à la main. Derrière son bureau vintage en fer bleu cabossé, fièrement baptisé « Finishing Room », un ouvrier inspecte l’œuvre achevée. Nobody is perfect ? La manufacture Alfred Sargent, si.

Lire aussi
Au Portugal, l’industrie du cuir et du textile se professionnalise