- Inspirations>
Contraction des mots « coopération » et « robotique », cobot désigne cette nouvelle génération d’humanoïdes collaboratifs et semi-autonomes qui s’installent peu à peu dans les entreprises du tertiaire. Officiellement, pour valoriser le travail des humains. Vraiment ?
Il y a dix ans, dans un petit hôpital du nord du Japon, j’ai croisé mon premier robot professionnel. Il était blanc et vert, haut de 1,3m, et il accueillait les arrivants pour les guider dans le dédale des couloirs. Tous les arrivants, sauf les étrangers dont le japonais était trop approximatif pour les fines esgourdes du guide artificiel. À l’époque, le Japon commençait à rêver de robots capables de remplacer les hommes dans les usines, dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux pour compenser le vieillissement de sa population. Dix ans plus tard, la grande mutation que certains appellent « le deuxième âge des machines » n’a pas encore eu lieu. Mais qu’importe, elle serait imminente. D’après un rapport du cabinet de conseil Roland Berger, 42% des emplois français pourraient être automatisables d’ici à vingt ans. De la même façon, dans un article commis en 2013, deux chercheurs de l’université d’Oxford, Carl Benedict Frey et Michaël Osborne, affirment que près de la moitié des emplois seraient menacés d’ici à 2035. Une page internet (goo.gl/e6vqgz) propose même à tout un chacun de jauger la probabilité qu’il a d’être prochainement remplacé par un robot. « L’estimation ne repose que sur quatre paramètres, ce qui la rend très imparfaite », nuance Raja Chatila, directeur de recherche à l’institut des systèmes intelligents et de robotique (Isir) de Paris. Il n’empêche, le portail permet de se faire une idée de la situation…
Vers un chômage (encore plus) massif ?
Il apparaît sans surprise que les métiers ne nécessitant ni qualification ni créativité sont facilement « déshumanisables ». Et cette mutation- là est déjà en cours : le géant Amazon dispose désormais de robots magasiniers dans ses centres de tri. Le taïwanais Foxconn, leader mondial du matériel informatique et principal sous-traitant d’Apple, s’est associé à Google pour créer des usines 100% robotisées, capables de fabriquer les iPhone 6. Chez le chinois Yingli, leader dans le domaine du panneau solaire, les machines sont aussi en train de remplacer les hommes, jugés trop maladroits et trop chers, y compris en Chine où la main-d’œuvre à bas coût se raréfie en raison de la politique de l’enfant unique et de l’élévation générale du niveau de vie. Plus surprenant : pour la première fois, des métiers nécessitant des qualifications parfois très poussées sont eux aussi sur la sellette. Ainsi, l’année dernière, un robot, nommé Vital, est entré au conseil d’administration d’une société spécialisée dans les investissements à hauts risques, Deep Knowledge Ventures. Capable d’analyser d’immenses bases de données et de jauger le marché, il a un rôle de conseil, mais, surtout, un droit de veto. Aucune décision ne peut donc être validée sans son accord ! Des robots commencent aussi à remplacer les courtiers en assurances, les traders, les vendeurs téléphoniques, les conseillers clientèle, les enseignants, les cuisiniers, les infirmiers, et les journalistes, en particulier sportifs et financiers – l’agence de presse mondiale et généraliste Associated Press utilise des robots journalistes depuis près d’un an. Enfin, des voitures automatisées – comprenez sans conducteur –, comme la Google Car, pourraient causer pas mal de tort aux taxis. « D’après l’Eurobaromètre, 73% des Européens sont inquiets à l’idée que des robots volent leur travail et engendrent un chômage massif, explique Maarten Goos, professeur d’économie du travail à l’université de Louvain, aux Pays- Bas. Depuis la révolution industrielle, les progrès techniques n’ont pas entraîné de chômage à long terme. Cela parce que la technologie permet de produire mieux et moins cher, de générer de nouveaux services… et donc de créer de l’emploi. » Pour l’économiste néerlandais, il ne peut pas en être différemment avec ce qu’il appelle la révolution numérique : « Les robots accompliront les tâches pour lesquelles la main-d’œuvre fait défaut et faciliteront le travail intellectuel ou les efforts physiques des employés. Des ajustements du marché de l’emploi seront tout de même nécessaires, puisque quantité de travailleurs verront leurs compétences devenir obsolètes. » une vision optimiste de la situation, qui n’est pas partagée par l’ensemble des acteurs. Certains pensent au contraire que la robotisation ne conduira pas à de réelles créations d’emplois et qu’elle engendrera des révoltes semblables à celles survenues au début du XIXe siècle en Angleterre, avec l’arrivée des premiers métiers à tisser automatisés. Pour tenter d’endiguer le phénomène, l’une des pistes envisagées par les chercheurs est d’améliorer, en amont, l’acceptabilité des robots par les employés, en les rendant faciles à programmer et sympathiques. « Personne ne s’interroge sur la réelle nécessité de recourir à de tels robots. Il s’agit de les faire accepter coûte que coûte par la société », remarque raja Chatila. L’un des meilleurs exemples de ce pan de recherche est le robot industriel et multitâche Nextage, du groupe japonais Kawada Industry, qui va jusqu’à réaliser les exercices de gymnastique matinale avec les employés. Le robot Baxter, de chez Rethink Robotics, peut quant à lui être reprogrammé par n’importe qui, juste en prenant sa « main » et en la déplaçant afin de lui montrer comment exécuter la tâche à accomplir. Ce dernier ne coûtant que 30000 euros, il pourrait rapidement trouver un débouché au sein des petites ou moyennes entreprises et permettre de passer de la production de masse à la personnalisation de masse.
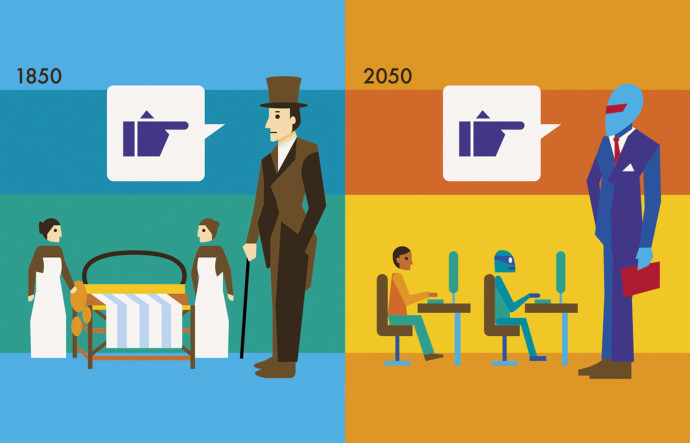
Ajustements sociétaux
L’autre piste envisagée, c’est le « cobot », le robot collaboratif. Le concept est né à la fin des années 90, après que le champion russe Garry Kasparov a perdu sa première partie contre Deep Blue, le supercalculateur d’IBM. Plutôt que de s’avouer vaincu par la machine, l’ancien champion du monde a eu l’idée d’un compétiteur d’un nouveau genre, le Centaure, qui combinerait la capacité stratégique des humaines avec la force analytique des ordinateurs. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, les championnats Freestyle Chess confrontent Centaures, humains et machines, et les capacités de ces hybrides dépassent systématiquement celles de l’homme et de la machine. Quant au terme « cobot », il a été inventé à la toute fin des années 90 par deux chercheurs américains, Michael Peshkin et Edward Colgate, pour l’industrie automobile, afin d’encourager la collaboration entre machines et humains. Dans ce cas précis, le cobot était destiné à apporter plus de précision et de force physique, notamment pour le portage d’objets lourds ou encombrants. L’idée étant donc d’augmenter les capacités des employés sans les remplacer pour autant. En théorie, la démarche cobotique est mieux acceptée par les employés comme l’a démontré l’histoire des métiers à tisser. « L’invention, par Jacques de Vaucanson, d’un métier entièrement automatique a été très mal perçue par les tisserands, contrairement à ceux, semi-automatiques, de Joseph-Marie Jacquard. Bien que plus complexes et plus coûteux, ils intégrèrent les usines sans difficulté », explique Edouard Kleinpeter, de l’institut des sciences de la communication du CNRS. Dans cette famille de machines d’un nouveau genre, on trouve les robots chirurgiens, qui permettent aux médecins d’opérer à distance ou de façon peu invasive ; les cobots relationnels, qui incarnent les attitudes ou bien les émotions d’un individu à distance ; les exo – squelettes, qui pourraient permettre de porter des charges très lourdes ou encore les cobots qui, dans l’aéronautique ou le transport, permettent de manipuler des éléments encombrants, minuscules ou toxiques. Une évolution qui n’est pas sans poser quelques casse-tête juridiques. Par exemple, en cas d’erreur médicale, qui est le responsable ? le médecin ? le robot qui a eu un problème technique, ou le fabricant ? Outre ces ajustements sociétaux, des progrès restent à accomplir pour s’assurer que le cobot comprend parfaitement les intentions de l’opérateur, qu’une réelle proximité – voire une intimité – les unit, tout en le maintenant dans une totale absence d’autonomie. « Par définition, les cobots ne peuvent se passer de l’homme », fait remarquer Bernard Claverie, directeur de l’Ecole nationale supérieure de cognitique, à Bordeaux. A quand l’inverse ? Car, dans le prolongement de la cobotique, des chercheurs rêvent déjà à l’émergence d’une forme de symbiose où l’homme et la machine ne feraient plus qu’un. Dans une vision différente du futur, les cobots pourraient aussi n’être qu’une étape transitoire pour faire accepter à la société des robots autonomes.

3 questions à Jean-Michel Besnier
Professeur de philosophie à l’université de Paris IV-Sorbonne (chaire de philosophie des technologies d’information et de communication).

The Good Life : Dans quel cadre philosophique s’inscrivent les robots professionnels ?
Jean-Michel Besnier : Les robots professionnels s’inscrivent dans le droit fil de la prospective ouverte au XIXe siècle avec les premiers métiers à tisser automatisés. Au XXe siècle, l’homme commence à être considéré comme le maillon faible des usines : il est lent et faillible, car il tombe malade et il fait grève. Conclusion : il doit être remplacé par des automates. Aujourd’hui, les robots prennent le pouvoir, non seulement dans le secteur manuel, mais aussi dans le milieu intellectuel ou dans le tertiaire. Il y a, par exemple, des robots journalistes qui écrivent des dépêches. En Corée du Sud, dans certaines écoles, les enseignements sont déjà prodigués par des robots, ce qui n’est pas sans poser de problèmes, car l’éducation ne se résume pas à l’arithmétique ni aux règles de syntaxe.
TGL : Vous parlez de prise de pouvoir par les robots. N’est-ce pas un peu fort ?
J.-M. B. : Non, pas du tout. Il n’y a qu’à regarder le rôle prépondérant des robots traders dans le krach financier de 2008. Malgré le désastre constaté, aucune décision politique n’a été prise pour encadrer l’autonomie de ces robots qui, par définition, réagissent plus vite que n’importe quel humain. Ce nouveau rapport de force explique que la question du droit des robots est appelée à devenir primordiale. Pour autant que je sache, elle n’est actuellement considérée que par les militaires qui, depuis la dernière guerre d’Irak, travaillent sur ce que nous pouvons légitimement attendre des robots ou des drones, ainsi que sur le moyen de les doter d’un sens moral. Les ingénieurs comme les économistes répètent à l’envi que les robots feront uniquement les corvées répétitives et que les tâches gratifiantes seront réservées aux humains, mais ce n’est pas vrai. Ils pilotent déjà des avions, conduisent des voitures, et pourront bientôt remplacer les taxis. Cela ne se fera probablement pas sans révolte, du moins dans certains secteurs d’activité. Pour le moment, nous vivons dans une société qui ne valorise que la réactivité, mais nous reviendrons forcément à des valeurs de convivialité et de réflexion. Il nous faudra alors poser des limites, circonscrire les choses, décider de ce que les robots peuvent faire ou non et leur interdire certaines professions, comme l’éducation.
TGL : Le futur des entreprises sera-t-il cobot ou robot ?
J.-M. B. : Bien malin celui qui pourra répondre à cette question ! C’est d’ailleurs pour cela que nous assistons à un retour en force de la prospective. Considérée comme trop dirigiste, elle avait été abandonnée il y a quelques décennies sur l’autel du capitalisme. Or, on commence à s’apercevoir qu’il n’est jamais très sain de se laisser guider par l’innovation. Il s’agit d’une fuite en avant, d’un darwinisme appliqué à la société. Les hommes doivent maintenant reprendre la main sur l’innovation. La France s’est engagée timidement sur ce terrain avec la création, en 2013, d’un commissariat général à la stratégie et à la prospective, dont l’objet est d’orienter les choix et de hiérarchiser les priorités. Il resterait sans doute aux politiques à moins reculer devant le débat public.
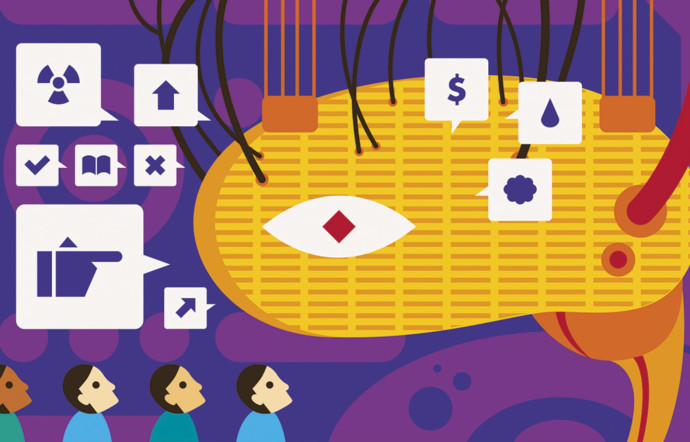
4 questions à François Jarrige
Historien, maître de conférences à l’université de Bourgogne, il a notamment publié Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences (2014) et La Modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français (2015) aux éditions La Découverte.

The Good Life : La crainte d’être remplacé professionnellement par une machine est-elle ancienne ?
François Jarrige : Depuis le XVIIIe siècle, les sociétés industrialisées ne cessent d’être travaillées par cette inquiétude. A chaque moment de recomposition du capitalisme et de mutation des systèmes techniques renaît le spectre de l’obsolescence de l’homme remplacé par les machines. Au début du XIXe siècle, déjà, des ouvriers s’insurgent parfois contre l’introduction de machines accusées de menacer leur travail, et quant à savoir si les techniques accroissent la misère et remplacent les travailleurs qualifiés, la question divise profondément les économistes. En 1803, Jean-Baptiste Say reconnaît, par exemple, que les « procédés expéditifs » remplacent les travailleurs, mais il affirme aussi qu’il s’agit là d’un « malheur passager », car, grâce au marché, les ouvriers doivent trouver à s’occuper ailleurs. Dans les années 1880, l’ingénieur et réformateur social Emile Cheysson s’interroge également sur les effets moraux d’un « chômage universel » provoqué par l’automatisation du travail. Et lors de la crise des années 30, qui voit à la fois l’accroissement du chômage de masse et la généralisation de nouvelles formes d’organisation du travail, comme le taylorisme, l’économiste britannique John Maynard Keynes prédit l’avènement d’un chômage technologique massif. Depuis quarante ans, alors que les sociétés industrialisées sont entrées dans une phase de chômage structurellement élevé, les débats et les prophéties sur la fin du travail provoquée par l’informatique et l’automatisation ne cessent de ressurgir.
TGL : La machinisation s’est-elle déjà traduite par une crise de l’emploi humain ?
F. J. : Bien sûr ! Toute l’histoire des deux derniers siècles est celle d’un bouleversement continu du marché du travail sous l’effet de l’accroissement de la productivité permis par la mécanisation et la rationalisation des tâches. De nombreux métiers artisanaux et agricoles ont disparu au fur et à mesure que s’étendait l’automatisation du travail. En 1946, le nombre d’actifs agricoles, qui était de 6 millions de personnes en 1946, est passé à 2 millions en 1970, car l’automatisation et la délocalisation conjuguent leurs effets et font massivement reculer l’emploi industriel. La question est de savoir ce que signifie « crise de l’emploi humain », car cette crise peut prendre de multiples formes : déqualification, chômage, problèmes de reconversion, transition difficile d’un secteur d’activité à un autre, etc. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les disparitions d’emplois dans l’agriculture et dans l’industrie ont été compensées par le développement des secteurs tertiaires et des emplois de service.
TGL : Pourrait-il en être différemment aujourd’hui ?
F. J. : Nous vivons depuis deux siècles sur l’idée que le progrès technique continu – qu’on appelle machinisation, automatisation ou robotisation – permet d’alléger le travail des hommes en remplaçant les tâches les plus difficiles ou les plus insalubres. Au milieu du XIXe siècle, des socialistes comme Etienne Cabet rêvaient que toutes ces tâches difficiles soient automatisées et que l’homme devienne ainsi une pure intelligence libérée du travail faisant mouvoir une armée d’automates à son service. Ce rêve de toute-puissance est recyclé à chaque nouvelle génération et nourrit l’imaginaire du progrès technique. Mais aujourd’hui, il semble effectivement que la situation qui se dessine soit différente. L’année dernière, deux économistes américains du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, ont publié un ouvrage fascinant, intitulé The Second Machine Age (« le deuxième âge des machines »), dans lequel ils analysent les effets des transformations technologiques en cours avec l’informatisation et l’expansion du numérique. Selon eux, ce deuxième âge se caractérise par l’automatisation des activités pour lesquelles les humains et les fonctions cognitives étaient jusque-là considérés comme indispensables. Alors que le premier âge des machines, qui s’était engagé avec la révolution industrielle au XIXe siècle, se caractérisait par l’automatisation des tâches nécessitant un effort physique, celui-ci viserait à remplacer des fonctions intellectuelles. Il semble dès lors qu’il n’y ait plus d’obstacles à substituer des robots aux humains dans l’ensemble des secteurs d’activité, ce qui rompt avec la thèse optimiste selon laquelle la disparition d’un type de travail est nécessairement compensée par la création d’activités dans un autre domaine.
TGL : Les ingénieurs étudient beaucoup « l’acceptabilité » des robots en entreprise. Est-ce une démarche nouvelle ?
F. J. : Non, cela n’a rien de nouveau, même si le phénomène prend de l’ampleur. Depuis le début de l’industrialisation, les capitalistes ont toujours dû accompagner et justifier les innovations qui menaçaient les travailleurs et les professionnels qualifiés. Au début de l’industrialisation, cela prenait parfois la forme brutale d’une escorte de gendarmerie chargée d’accompagner l’installation des machines. Depuis, de nombreux professionnels de « l’acceptabilité » ont vu le jour. Leur mission est d’acclimater les innovations – qu’elles soient organisationnelles ou techniques – afin d’éviter les conflits et de convaincre les ouvriers, les usagers ou les consommateurs de l’intérêt des nouvelles méthodes. Alors que la concurrence internationale s’accroît, que les syndicats sont affaiblis et les travailleurs toujours plus atomisés sur leur lieu de travail, les capacités de résister et de négocier ces changements semblent diminuer.




















1 comment
Comments are closed.